Manufacture des utopies
— Il faut que je me présente, c’est bien ça ? Moi, c’est Henri… et j’habite toujours dans mon HLM près de l’École des mines. Un an après l’Haraka, on s’est misEs à casser les murs de nos apparts. C’était un peu fou, on a tout réorganisé ! Avec mes voisinEs, on avait tellement traîné ensemble sur les barricades et les piquets de grève que nos intérieurs nous ont semblé minuscules, tout étriqués. Alors on a décloisonné, droit d’usage généralisé ! On a mis en place une cantine collective, réorganisé les pièces-cuisine de chaque foyer. Les ados ont revendiqué un étage entier. Des couples ont enfin pu avoir leur chambre solo. Ma fille s’est barrée dans l’espace « jeunes » et je me suis installé avec deux amiEs du groupe méca.
— Nous au contraire, on a laissé tomber nos apparts miteux pour s’installer dans la maison de maître juste là. On s’est retrouvéEs une vingtaine à partager quinze pièces ! Changer nos habitudes, ça a été assez dur, et devoir penser au jardin, au bois, au ménage et à la prépa des repas…
Au « Pied de biche », regroupéEs à une quinzaine dans ce bar associatif stéphanois au murs bariolés de rouge, l’ambiance est à la fois fourmillante et attentive, d’humeur joueuse.
— Et alors, comment vous êtes-vous rencontréEs ? intervient l’unE des animatricEs.
— Sainté, c’est pas si grand, reprend Bob, concentré. En 2013, on a monté une coordination des communs à l’échelle de toute la ville. À la première réu, j’ai croisé Henri. L’idée était de référencer nos manières de nous organiser dans chaque quartier, de lister les communs qui nous manquaient et ce qu’on pouvait améliorer.
— Avec Bob, poursuit Henri, on a lancé le groupe « bains publics ». On est tous les deux plombiers de formation, alors ça aide.
Petite bourrade complice entre les deux qui amène une rumeur de sympathie dans l’assemblée. Il enchaîne encore :
— Dans le quartier du centre, iels avaient réquisitionné une boîte à sauna pour en faire des bains publics. On a trouvé ça génial. Aussi parce qu’on en avait marre de réparer les fuites de toutes ces salles de bain individuelles. On a mis en place des salles d’eau avec baignoires XXL, bidets, douches à l’italienne. Une pièce commune, ça plaisait à beaucoup. Et ça faisait moins d’entretien. On a réquisitionné des clubs de sport, des annexes de gymnases…
— Qu’on se douche chaque jour ou une fois par semaine, tout le monde a accès à une baignoire !
— Mais, attends, coupe une autre participante, toutes ces réquisitions, comment se sont-elles décidées ?
Enfiler les bleus de travail
De mai 2018 à décembre 2019, nous avons animé quatre-vingt-six « labo-fiction » en France, en Suisse et en Belgique. Pendant ces ateliers, nous avons pratiqué, avec plus d’un millier de personnes, un grand jeu de rôle dont le but était de dessiner un autre présent. Un présent aussi proche du nôtre que possible… au détail près qu’une révolution anti-autoritaire, mondialisée et victorieuse serait survenue, dix ans plus tôt, donnant naissance aux communes libres et aux régions autonomes de ce que l’on nomme maintenant l’Haraka.
Notre labo-fiction s’appuyait sur Bâtir Aussi, un bouquin que nous venions de publier, décrivant des mondes sans états, sans capitalisme, en travail sur les dominations… et qui nous faisaient envie. L’écriture avait débuté en 2011 et c’est à ce moment-là que nous avions décidé de faire fourcher l’Histoire, imaginant que ces élans révolutionnaires en Tunisie, en Égypte, au Maghreb et au Moyen-Orient se répandaient plus loin, jusqu’à gagner toute la planète. Où en serions-nous dix ans plus tard, alors que ça se stabiliserait, que ça commencerait à aller mieux ? De fil en aiguille, de dynamos en rites funéraires, de lave-linges en assemblées, nous avions tenté de nous représenter les objets et les techniques qui composeraient notre quotidien, d’imaginer où et comment habiter, concrètement. Nos week-ends d’invention, égrenés sur sept années, avaient été d’immenses bouffées d’air au milieu de nos habituelles activités de luttes. Nous avions commencé à trois ce jeu de ficelles, cette co-construction d’imaginaires où nous tirions quelques fils et qui devenaient au gré de nos échanges des figures complexes. Un jeu passionnant, réconfortant et inspirant que d’oser se projeter dans des futurs habitables et joyeux. Ce jeu qui nous avait donné la force pour lutter, qui nous avait fait tellement de bien, forcément, nous ne voulions pas le garder pour nous.
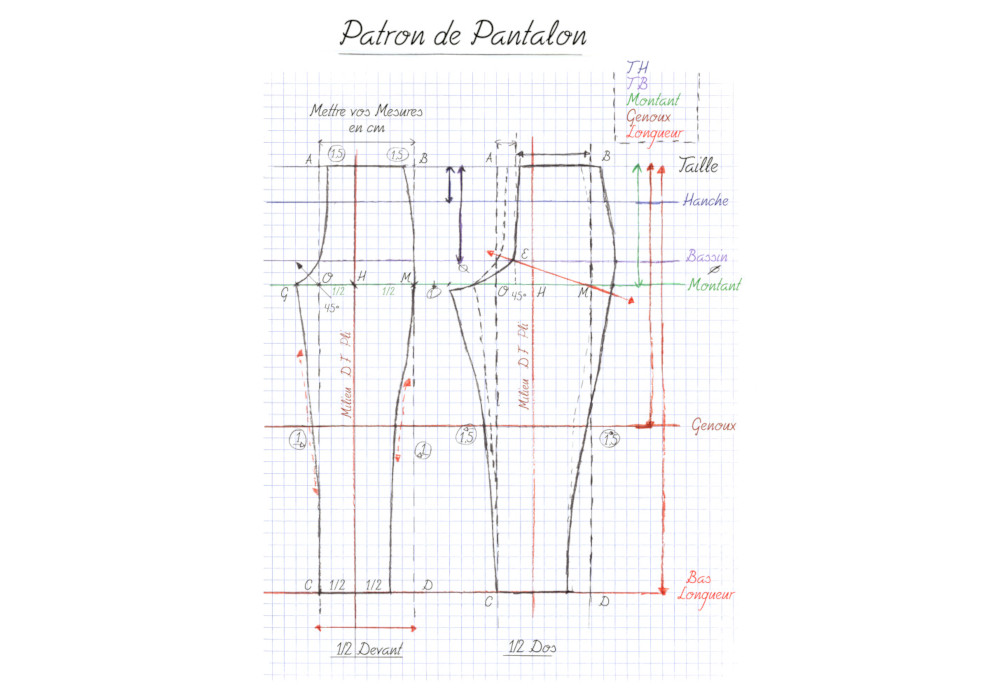
Carder : brosser nos idées et commencer à filer
— Moi, c’est Sabine. Dans la vie, j’aime marcher, je me balade tous les jours dans les montagnes autour de chez moi. Je fais des cueillettes, je rends visite aux voisinEs. J’ai fini par prendre l’habitude d’amener les colis et les lettres, j’suis un peu la postière du hameau. Je n’ai pas l’impression que ce soit devenu mon métier, je ne me force en rien. C’est plutôt ma fonction sociale, la place que je me suis trouvée.
— Et tu faisais quoi dans l’Antémonde ? demande Pierrick, un grand type assis à l’autre bout du cercle, l’air surpris.
— Je faisais du service à la personne, femme de ménage à domicile pour les vieux et plongeuse dans un restau. J’ai gardé la partie qui me plaisait, rendre visite aux gens, prendre des nouvelles et bavarder.
Pierrick reprend avec le même étonnement :
— Comment tu trouves le temps ? Entre mon travail au pôle de recherche, le groupe de dépollution de la rivière, mon cours de portugais et les tâches collectives de mon immeuble, je ne sais pas où donner de la tête ! En comparaison, tu as l’air vraiment de te la couler douce…
Sabine semble amusée et Pierrick pousse un soupir de conclusion :
— Heureusement qu’on a gardé les cinq semaines de congés ! C’était quand même un acquis social de l’Antémonde. J’vous jure, moi sans ça, je ne ferais jamais de pause. Il y a tellement à faire.
Sabine lui renvoie sa question :
— Et toi, tu faisais quoi dans l’Antémonde ?
— J’étais ingénieur dans le nucléaire. Au moment du basculement, ça m’a semblé important de rester à Grenoble et de m’investir dans les labos de recherches autour des énergies propres. J’ai énormément contribué à la maintenance du barrage du Chambon.
— Ah oui, tu as une fonction sociale hautement estimée…
Sabine ne peut s’empêcher un ton de jugement. Pierrick fait mine d’ignorer la remarque et explique encore :
— Au fond, c’est pareil qu’avant, je n’ai jamais de temps pour moi. Ni pour voir grandir mes deux nièces, ni pour passer plus que quelques soirées par mois avec ma compagne…
— Mais y’a plus personne pour te l’imposer, ce rythme ! Et tu n’as plus d’argent à gagner pour payer ton loyer !
— Faut bien faire tourner la ville et développer nos techniques. Il n’y a plus d’argent mais il y a encore un sens des responsabilités collectives, j’peux pas ne rien faire.
Le ton de Pierrick est amer mais aussi un peu fier. Il se redresse sur sa chaise avec un sourire satisfait. Sabine secoue frénétiquement la tête :
— Je me sens bien mieux depuis que je ne cours plus après l’argent. Je fais ma petite vie, à mon rythme et ça ne veut pas dire que je n’ai pas le sens des responsabilités collectives et que je ne fais rien. Je participe régulièrement aux chantiers de la commune et je file des coups de main à Yvette, une des aînées du village. C’est juste que je vis plus simplement au gré de mes envies.
Embarquer douze, trente ou soixante-dix personnes pour leur faire ressentir en deux ou quatre heures d’atelier les effets d’une création commune… c’était évidemment un objectif d’une ambition gigantesque. La meilleure option nous a semblé d’imaginer en parlant plutôt qu’en écrivant. Écrire est un exercice qui paraît souvent rébarbatif, hors de portée. Et d’autant plus lorsqu’on a fait peu d’études, que l’on n’a pas de pratiques régulières de l’écrit ou que personne ne nous demande jamais notre avis. Nous voulions construire un moment ouvert, amusant, et certainement pas réservé aux milieux intellectuels et militants. Un outil d’éducation populaire offert au plus grand nombre, qui ouvre des portes vers l’imagination, l’air de rien. Nous nous sommes donc lancéEs dans cette tournée incroyable, dans cinquante-huit villes et villages, dans des bars, des bibliothèques, des squats, des lieux associatifs et des librairies, dans des centres sociaux, des salons du livre et des centres d’art, dans des jardins occupés, des festivals de musique, des événements féministes, des théâtres, des locaux syndicaux ou encore des salles de classe.
Inventer des mondes à plusieurs est avant tout rassurant : agglomérer différents cerveaux pour ne pas porter seulE la charge d’une pensée complexe, désamorcer la pression à devoir se prouver personnellement, favoriser le foisonnement et le jeu. Quelque chose d’un peu incontrôlable qui cherche tout de même à s’affiner, à trouver une intelligence commune. Bien sûr, harmoniser des récits à nombreuSEs est un exercice difficile, frustrant, rarement abouti. Mais il est aussi tellement réconfortant de ressentir la subtilité qui s’accumule par couches successives, un peu comme une toile où chaque touche de pinceau viendrait composer avec les précédentes, pour donner de l'épaisseur à l’ensemble. Cette démarche collective nous ressemblait, parce que nous étions portéEs depuis des années par des collectifs anti-autoritaires où nous cherchions l’horizontalité dans les relations et les tâches, dans la circulation des pensées. Nous espérions que chacunE y trouve sa place, plutôt que de valoriser quelques rares personnalités. Partant de là, porter ce nom collectif, les « Ateliers de l’Antémonde », c'était se mettre en retrait en tant qu’autricEs pour inviter d’autres personnes à peupler à leur tour l’Haraka.
Éviter la starification dans la vie réelle mais aussi dans nos imaginaires… La littérature d’aventure fabrique le plus souvent des héroïnEs et même, plus spécifiquement, des héros lancés dans de grandes quêtes pleines de hauts faits, de nécessité à sauver le monde, d’efforts admirables, parfois sacrificiels, désespérés ou même ratés mais néanmoins grandioses et qui gomment la densité du quotidien pour nous parler de l’exceptionnel. Nous aimions ces histoires qui redonnent de la place aux détails de la vie, aux gestes intimes, aux événements modestes et que tout cela prenne des allures d'épopée captivante. Et nous le lisions bien plus souvent sous la plume d’Ursula Le Guin, Octavia Butler, Margaret Atwood ou Becky Chambers, que sous celle d’Alain Damasio. À nos yeux, il y avait quelque chose de profondément féministe dans le refus d’une écriture univoque, massive, dogmatique, virile, guerrière et finalement méprisante. L'émancipation ne peut jamais prendre la forme d’un sauvetage. Aucun chevalier servant ne nous libérera, aucun justicier du futur n’inversera le magnétisme des pôles ni ne freinera le réchauffement climatique. Seuls des mouvements sociaux d’ampleur forceront des changements de société capables d’agencer un monde plus habitable. Et ce sont les personnes opprimées qui prendront par elles-mêmes, et plus sûrement à plusieurs, les moyens de leur libération.

Plier : nouer les fils sur le métier à tisser
J’habite dans une « lieue ».
— Une quoi ?
— Une auberge qui accueille les gens en itinérance. On a récupéré d’anciens semi-remorques et on en a fait nos maisons, à côté d’une vieille ferme en lisière de forêt. On est au bord de la route qui mène à la grande ville donc y’a pas mal de passage.
— C’est marrant, j’ai rarement été hébergé en camion… Le plus souvent, je m’arrête en ville, là où des rez-de-chaussée d’immeubles sont réaménagés pour les itinérantEs. Je dis ça parce que j’habite principalement sur la route justement, dans une grande meute, on est une centaine.
— Ça fait du monde à loger d’un coup…
— Oh, pas tant que ça, l’itinérance est un mode de vie répandu. Nous, on fait du voyage longue distance entre Bangalore et Glasgow, on échange les denrées rares. Pas de bénefs, juste de quoi vivre et le reste est déposé là où on passe.
— Ça c’est chouette, parce que moi, je cuisine beaucoup de riz, je suis intolérante au gluten et mettre du curry ou du ras-el-hanout dans mes plats, ça compte !
— Bah le gros de notre cargaison, ce ne sont pas les épices : nous on collecte les plantes médicinales, l’opium, ce genre de choses… On travaille avec des pharmacies, des petits labos qui produisent des médicaments le long de la route. Échanger les plantes de différents climats et latitudes, c’est vital.
— Moi qui me voyait déjà en rade de médocs pour mes migraines… Je croyais qu’on ne faisait plus rien circuler et là, tu me sauves la mise !
— Oui, mais ça n’empêche pas que nos habitudes alimentaires aient considérablement changé, non ? On a pas mal relocalisé ces dernières années : nos modestes caravanes n’ont rien à voir avec le trafic d’avant.
— Ouais, d’ailleurs je ne sais pas depuis combien d’années je n’ai pas bu de café. En ce moment, j’en rêve souvent… Ça me manque, c’est fou !
— Et la racine de chicorée ?
— C’est bon… mais c’est pas pareil.
— Une petite nostalgie de l’Antémonde ? Le café clope du matin ?
— Ah ! Moi, j’étais plutôt à l’américano, sur un banc au soleil, avec un journal people !
— Mais tu sais que j’en bois souvent moi des américano ? À chaque voyage, quand je suis en Inde… Bon, ça ne s’appelle pas comme ça, mais ça a vraiment le même goût. Le café est produit au Vietnam et on le boit comme ici avant, dans des cafés, avec comptoir, terrasses et tout !
— C’est vrai ça, vous vous rappelez ? On avait des « cafés » qui vendaient du café ! Et ça a disparu en dix ans…
La première étape du jeu de rôle consiste à se mettre par deux, avec une personne qu’on connaît peu ou pas du tout. La consigne est de se présenter l’unE à l’autre, dans le présent de l’Haraka, en binôme chuchotant, pour inventer à la volée ce que nos vies auraient pu et pourraient être, dix ans après le début de cette révolution, des vies que nous aimerions vivre. Être face à face et se raconter nos vies fantasmées, pendant une petite demi-heure, c’est intime, souvent déroutant, ça nous fait plonger dans un inconnu étrangement bancal et familier.
– Partir de soi, travailler sur l’intime, c’est pas politique ça… souffle Thierry dans sa barbe.
— Vous individualisez les enjeux, au lieu de penser la globalité, ajoute Jean-Michel. Ce n’est pas comme ça qu’on peut concevoir des perspectives politiques qui se tiennent…
— Rien de réaliste ne peut sortir de cette accumulation d’anecdotes !
— Moi, je trouve que parler au « je », c’est égocentré. Ça fait le jeu du libéralisme. Il est où votre projet de société ?
Quelques grincheux, partisans de la rigueur argumentaire, ont effectivement rechigné à entrer dans le jeu. Heureusement, ces sceptiques furent plutôt rares dans la tournée, à peine une poignée. Et, étrangement, toujours des hommes, blancs, visiblement cultivés et qui avaient, à n’en point douter, beaucoup réfléchi dans leur vie, et encore plus souvent parlé. Nous avons tenu bon, convaincuEs qu’il y avait du politique, du global, du collectif et assez de sérieux dans ce que nous proposions. Les labo-fiction partent de personnes réelles qui se projettent dans des personnages, leurs parcours singuliers, quelques anecdotes de leur quotidien imaginé. Découvrir le monde par leurs yeux, subjectivement, est une manière de ne surtout pas élaborer de programme politique. Nous craignons les recettes toutes faites qui se transforment en planifications à large échelle et qui, de leçons de morale, vrillent en élans totalitaires. Cette utopie que nous cherchons à tâtons est composée de toutes ces personnes en désaccord, sans vision globale, même si elles font d’incessants efforts pour prendre de la hauteur, s’associer, se comprendre. Il était passionnant d’imaginer des univers qui acceptent ces limites, l’incapacité à tout penser et à tout saisir. Vouloir tout contrôler est non seulement irréaliste mais aussi terriblement dangereux. Il était nécessaire de penser cette tension entre le désordre de la vie et nos efforts pour l’organiser. Partir de personnages qui nous ressemblent pour donner de la place, au-delà de nos intentions utopiques, à nos points aveugles, nos mauvaises fois et nos colères mal placées. Mêler dans la fiction suspense et agacement, tendresse et perplexité, pour se parler du réel et nous mettre sur la voie de cette complexité qui fait bel et bien société.
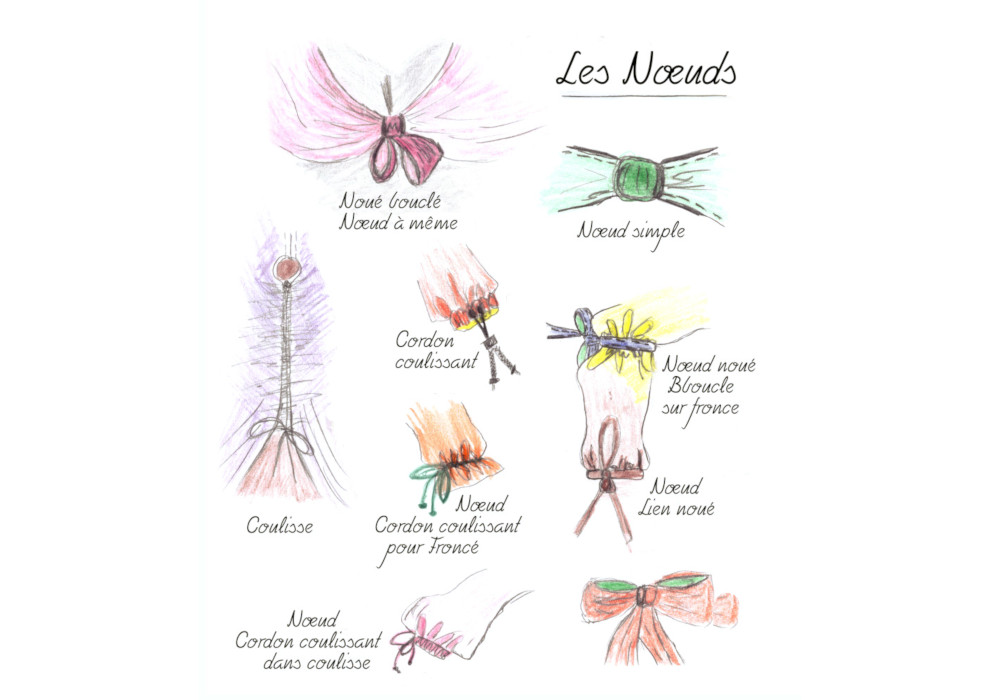
Huiler les rouages du métier à tisser
Se lancer dans le jeu et essayer de lâcher prise comme si on avait cinq ans et que l’on commençait à y croire, par la simple force du récit au présent de l’indicatif. Attraper un premier fil, puis deux, une idée qui nous sort des yeux, ou du ventre. On tire ces fils devant soi, bras tendus et ça nous balade, étrangement, comme si on était à la fois marionnette et marionnettiste, complices. On ne fabrique pas de la fiction à partir de rien mais à partir de soi, du réel, de ce que l’on connaît. Et ça commence à être plus facile. Mais c’est aussi, souvent, un moment de renoncement car on est aisément aspiréEs par l’imaginaire du chaos politique, de la pénurie et de la guerre. Il faut alors se demander ce que nous sommes capables de mettre en œuvre dans cette société subitement sens dessus dessous. Bien des binômes ont d’abord imaginé une grande régression, la perte des moyens énergétiques, de déplacement, de communication, la disparition des hôpitaux et des médicaments…
— En arrivant chez vous, j’avais plein d’histoires à partager.
— Des histoires ?
— Oui, parce que depuis qu’on n’a plus de papier, on est devenu super fortEs dans la transmission orale. Et moi, comme je ne voulais pas passer ma vie à cultiver des légumes comme la plupart des gens, alors j’ai décidé de devenir colporteuse : je vis sur les routes, je collecte les nouvelles, les savoirs, les histoires… et je les redistribue à qui veut bien me loger et me nourrir quelques jours.
— Waow, tu collectes tout ça dans ta tête, sans papier ‽ Mais, tu sais que chez moi, iels ont relancé une papeterie, juste à côté de la scierie. Je suis encore passé leur déposer un stock de manuels de marketing à recycler la semaine dernière. Les vieux bouquins affluent de partout, une fois qu’on a placé quelques exemplaires en bibliothèque, on peut récupérer le reste… On ne manque vraiment pas de papier. Tu devrais attraper plusieurs ramettes en repartant… Si tu veux, je leur passe un coup de fil ?
— Euh, attends, vous avez aussi le téléphone ?
— Bah oui, les poteaux et les câbles étaient déjà en place, on n’avait pas de raison de les enlever…
Si le premier élan est souvent de projeter un monde très peu technologisé, c’est sans doute que capitalisme et technologie sont étroitement imbriqués dans les imaginaires. Alors que les premières productions de papier remontent à l’antiquité, nous avons été frappéEs de constater à quel point certainEs avaient du mal à concevoir sa fabrication dix ans après la disparition de l’Antémonde. Si nos visions convergeaient avec la plupart des participantEs sur le fait que nous n’aurions plus de smartphone en poche dans l’Haraka, nous avons été étonnéEs que le téléphone filaire disparaisse si complètement. La place hallucinante prise par la téléphonie mobile en moins de vingt ans occulte-t-elle à ce point le système de communication précédent ? Comme si la sophistication de nouveaux outils nous faisait oublier du même coup l’existence d’une technologie plus simple, juste un peu plus ancienne et dont l’infrastructure est encore largement en place et accessible.
En faisant si vite le deuil de ce qu’iels s’imaginaient incapables de maintenir ou de fabriquer iels-mêmes, les participantEs nous immergèrent souvent dans des infra-sociétés autarciques et laborieuses. C’est sans doute un des symptômes du système technicien : à vivre tellement séparéEs de la production des objets du quotidien, difficile d’envisager s’en réapproprier les savoir-faire et les trajectoires. Plus difficile encore de projeter de nouvelles techniques de production lorsqu’on n’a aucune idée de ce qu’elles impliquent concrètement.
— Je vous coupe, juste pour dire qu’il reste encore une dizaine de minutes… et vous donner une consigne supplémentaire : imaginez maintenant comment vous vous êtes rencontréEs, dans cette réalité parallèle. Peut-être travaillez-vous ensemble, à moins que vous habitiez au même endroit ou que vous vous croisiez quelque part… À vous de voir !
Au milieu de ces premières vingt-cinq minutes, les animatricEs passent ainsi de binôme en binôme avec cette nouvelle proposition : scénariser un lien, des besoins, un désaccord, une envie de solution. Une maraîchère fatiguée des conflits communautaires de son village prend l’occasion du passage d’un zeppelin pour aller chercher le précieux sucre qui leur manque, puisqu’iels n’ont pas encore réussi à réimplanter des essaims d’abeilles dans la plaine trop polluée. Un petit voilier solitaire parti de Dunkerque se décide à rejoindre la flottille en provenance de Porto, qui longe la côte avec son épicerie et son université populaire embarquées. Une rage de dent interminable motive un musicien solitaire à rejoindre un collectif de soins dentaires parisien qui, à ses heures perdues, démonte pièce par pièce la tour Eiffel pour des constructions plus horizontales. Deux inconnues conviennent qu’elles habitent en réalité dans le même village depuis près de cinq ans et qu’elles sont devenues très bonnes amies… On se met à rêver d’aventures et d’issues de secours, ça se ramifie, on s’autorise à imaginer plus loin puisque l’on se met en relation. La marionnette qui danse devant nous s’autonomise, ce n’est plus nous qui tirons sur ses fils mais elle qui nous entraîne : nous courons après elle pour voir ce qui lui arrive. La fiction nous embarque et nous raconte des choses sur nous-mêmes que nous ignorions encore.

Tisser une large toile
— C’est l’heure ! On se remet ensemble ?
L'étape suivante est un changement d'échelle. Nous nous remettons en cercle, nous sommes douze ou trente, et chacunE rapporte ses premières bribes d’histoires, les circonstances de cette rencontre à deux. Pendant une petite heure, la parole circule et nous continuons d’inventer, comme ça vient. Il n’y a pas de mauvaises réponses, juste une profusion d’idées qui s’empilent et se combinent. Le paysage prend avec la sensation d’un monde en train de se révéler. Des visions opposées sur les techniques mises en œuvres ou abandonnées s’ajustent et s’affinent. Nous réalisons que toutEs les ingénieurEs, les médecinEs, les techniciennEs n’ont pas disparu avec la révolution, que la plupart vont continuer à maintenir ce qu’iels savent maintenir ou réfléchir à démanteler ce qui ne fait plus sens. Il faudra peut-être les forcer un peu. Discuter en tous cas. La fiction est collective, grouillante et difforme. Les savoir-faire des unEs et des autres alimentent les possibles, nous rassurent et nous font finalement ressentir que « faire société » n’est pas se limiter au cercle connu mais compter sur les autres, qu’on ne connaît pas, ou pas encore. Il y aura bien quelqu’unE, quelque part, pas forcément très loin, pour nous aider à trouver des solutions. Il y aura bien du monde pour relancer une usine de préservatifs à base d’amidon de maïs, pour nous expliquer par quel bout prendre le refroidissement d’une centrale nucléaire, pour proposer des soirées théâtre ou des séances de psychothérapies pendant que je me concentre sur la pousse des céréales… C’est la multitude des gestes de partage et d’entraide qui prend force. Nous ne sommes pas obligéEs de tout faire, ni de nous limiter pour tout. Les possibles se déploient à la limite de notre champ de vision… Et finissent parfois en débats politiques acharnés pour ou contre la gestion des ordures à l’échelle régionale, pour la promotion de quelques technologies de pointe ou leur bannissement.
En début d’atelier, la présentation de l’Haraka déploie une perspective libertaire, celle d’un monde d’une grande diversité culturelle dans les modes de décision et de production. Le pari est que des organisations collectives divergentes s’articulent sans s’homogénéiser ni se nuire, s’agglomèrent d’une région autogérée à l’autre. Dans la fiction, les visions se confrontent avec un peu moins de jugements et de colères que dans les habituels débats politiques. Nous explorons des hypothèses, certaines irréalistes ou antagonistes, mais toujours ça circule, ça se complète sans se mettre en concurrence. Nous voyageons avec cette idée que technologies et mondes sont imbriqués, qu’on ne peut pas penser l’usage d’ordinateurs blindés de nanopuces sans le monde capable de les produire et, inversement, qu’on ne peut pas penser nos mondes idéaux sans envisager les machines que nous serons capables d’y fabriquer. Et dans ce façonnage à tâtons, émerge la conviction que notre idée du désirable doit inclure la possibilité d’une cohabitation avec des personnes dont les choix nous hérissent… et que ce voisinage ne peut être durable sans un espace de négociation, d’ajustement, d’arrangements et d’alliances par proximité.
Cette toile d’araignée de désirs et de désaccords finit par redonner un goût de réalisme à nos attentes matérielles, tout en nous autorisant enfin à nous débarrasser du capitalisme industriel dévastateur et des logiques productivistes qui collent à la peau.
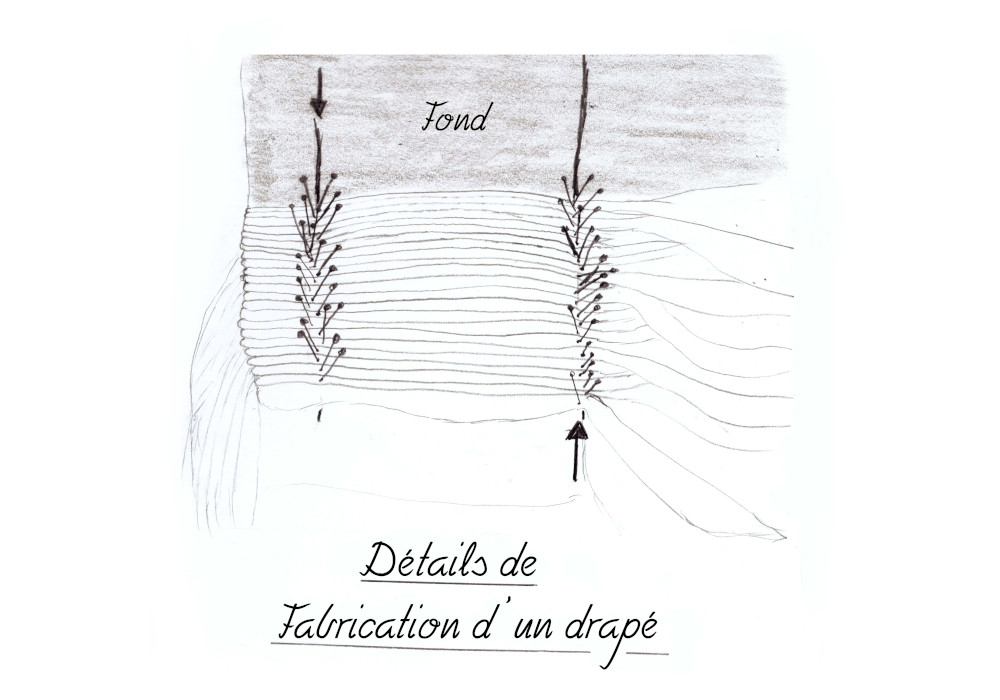
Fouler: Feutrer le tissu et le rendre solide
— Et tu es venue comment à cette rencontre ?
— Oh bah à vélo, comme d’hab. J’ai mis une petite semaine…
— Vous n’avez pas le train chez vous ?
— Non. Ni train, ni voiture, ni avion.
— Ça doit pas être facile… Par ici, on a maintenu les lignes ferroviaires, c’est vachement bien. On en a rouvert d’autres même. On était tellement nombreusEs à vouloir se déplacer, sans compter les marchandises. Ça évite de charger inutilement des chevaux et des bœufs. Et pour transporter rapidement des personnes malades, y’a pas mieux.
— Mais ils roulent à quoi vos trains ?
— À l’électricité bien sûr. Ce qui demande le plus d’énergie, c’est le démarrage des locos. Alors les seules gares ouvertes sont celles situées à côté de centrales électriques, barrages, champs d’éoliennes… Ensuite, le train génère le plus gros de son énergie en roulant.
— Et ça marche ?
— Carrément. À la base, ce sont des cheminots qui ont initié le truc, ils s’y connaissaient. Ils ont même gardé leur nom d’avant, la CGT-Cheminot. C’est une grosse organisation, un peu autoritaire des fois mais en même temps, ils sont ouverts, prêts à te former, pourvu que tu t’engages à un ou deux jours de service par semaine, au minimum.
— Mouais… On se déplace quand même moins qu’avant.
— Tu rigoles ! Depuis qu’on a aboli les frontières et que c’est gratuit, je bouge tout le temps, j’adore ça !
— On met quand même plus de temps pour aller d’un point à un autre…
— Oui, c’est pour ça qu’on fait rarement des aller-retours express. On part plutôt en tournée. Mais pas en passant notre vie à pédaler… Vive le train !
— Tous ces vélos différents, c’est quand même enthousiasmant, non ? Les tout-terrain à remorque, les rosalies, les cyclo-cargo, les vélos à voile qui foncent à 70 km/h sur l’autoroute… Et les TGV !
— Les TGV ?
— Oui, les Très Grands Vélos !
— Vous rigolez sur les TGV, mais moi, j’ai de la famille au Brésil et iels me manquent tellement… Et partir trois mois, dont la moitié sur un bateau, ce n’est vraiment pas imaginable pour moi, j’ai le mal de mer et l’eau, ça me fait peur. Mon espoir, c’est qu’on relance les avions long courrier…
— Vous savez quoi, l’année dernière, j’ai fait un truc vraiment spécial : j’ai enfourché ma mobylette à double carbu, alcool de patate et huile de friture, depuis mon petit patelin, j’ai attrapé la péniche-express pour descendre le Rhône jusqu’à Marseille, puis le train pour Istanbul. Tout ça en moins de deux semaines.
— Tu es allée à Istanbul ‽
— Oui, parce que là-bas, iels ont ré-ouvert un observatoire astronomique, avec une lunette géante, montée dans une montgolfière câblée, et moi, l’observation du cosmos, ça me passionne…
Nous voulions avant tout transmettre un enthousiasme. Il ne s’agissait pas de créer une utopie hors-sol, un monde idéal et sans problème. Car si tout était lisse, sans grincement ni désaccord, ce serait louche, probablement autoritaire. Un monde parfait serait à l’opposé de ce que nous imaginions comme une vie bonne, une vie avec ses problèmes qu’on ne peut pas toujours résoudre, ses injustices et ses chaos incompressibles mais qu’à force de tendresse, d’inventivité et d’obstination collective, nous parviendrions à rendre vivable et enviable. Une utopie bourrée d’ambiguïtés, selon les termes de l’autrice de science-fiction Ursula Le Guin, une utopie merdique comme nous avions fini par la nommer nous-mêmes. Partir de ce qui nous semblait souhaitable, s’autoriser à penser que ça pourrait advenir, puis étoffer ce qui se passerait entre-temps pour que cela advienne. Et dans cet aller-retour entre présent antérieur et futur proche, s’autoriser les points de résistances, les rapports de dominations et les violences, bref, les chaos merdiques dont est tissé le quotidien, mais sans jamais perdre de vue que globalement, ça commencerait à aller mieux.
Nous voulions creuser du côté du désirable parce que nous étions fatiguéEs des scénarios d’horreur, ce qu’on appelle, par opposition aux utopies, des dystopies. Envisager en permanence le pire permet aux puissants d’imposer des conditions de vie et de travail toujours plus pénibles. La peur du lendemain pour nous résigner à un présent lamentable. La haine de l’autre et la fabrication d’une guerre entre pauvres pour diviser et isoler, pour désamorcer tout désir commun qui contesterait l’ordre des puissants. Caméras à chaque coin de rue et rejet des différences. Peur de perdre son travail, sa retraite, sa dignité. Angoisse du cancer, du terrorisme, du climat, des psychopathes et de tous les monstres… Nous voulions prendre le contre-pied de la peur et imaginer nos vies belles et collectives. Nous faisions le pari que s’approprier des imaginaires positifs fracturerait cette dynamique d’individualisation et d’asservissement.

Broder de joyeux motifs
— J’habite seule dans la maison de ma grand-mère, nous raconte Emma, 8 ans, assise sur cette place de village ensoleillée près d’une amie à peine moins âgée. J’occupe surtout le rez-de-chaussée, je passe mes journées à bricoler, à réparer des téléphones, des tablettes.
— On n’habite plus ensemble ? lui demande sa mère qui ne peut s’empêcher d’intervenir.
— Non, je préfère habiter seule mais ça ne veut pas dire qu’on ne se voit plus, des fois vous venez me rendre visite. Et puis j’ai Solo… c’est un très grand robot…
Un peu piquée, la mère continue :
— Et tu ne vas plus à l’école ?
— Si, si, mais seulement quand j’en ai envie. Ça me prend du temps de réparer des machines, c’est comme ça que je gagne ma vie. Je troque contre les réparations. Mais j’aime bien y aller quand même, je vois mes amiEs et surtout maintenant, c’est récré toute la journée !
— Ouais, on choisit ce qu’on étudie, s’immisce Zoé. On s’est rencontrées avec Emma à l’école, on a construit Solo ensemble avec des adultes et d’autres élèves. Il prépare les repas. Alors j’aime bien aller dormir chez Emma pour que Solo me fasse mon petit déjeuner.
— Tu habites avec Emma ? interroge une autre participante.
— Oh non maman moi j’habite dans une grande maison avec plein de gens.
— Alors papa et moi, on est toujours avec toi, acquiesce la deuxième mère.
— Oh, bah non ! C’est une maison interdite aux adultes… C’est même toute la ville qui est occupée par des enfants, la ville de Bordeaux en entier.
— Il n’y a pas unE seulE adulte avec vous, dans toute la ville ?
— Non. Les parentEs ont le droit de venir en visite, pour une journée et une nuit. Et seulement si leur enfant est d’accord.
— Et vous vous débrouillez ?
— La voiture est interdite partout, il y a des grandes barrières à l’entrée, comme ça, on peut se déplacer sans faire attention tout le temps, on peut jouer et tout… Et on cultive des légumes. Mais on en a trop, parce qu’on sait très bien faire. Alors on en charge sur des bateaux qui remontent le fleuve pour en distribuer dans les villes et les villages plus loin. Ça se passe très bien oui !
Penser nos désirs à plusieurs, c’est non seulement découvrir que nous avons des désirs (malgré un futur prétendument bouché) mais aussi que nous pouvons les transformer ensemble. Car dessiner un monde affranchi du pouvoir de la finance, de la propriété, de la production industrielle et de tous les conforts qui font la misère du plus grand nombre, conduit forcément à réajuster nos désirs. À les confronter, les négocier, les revoir à la fois à la baisse et à la hausse, bref, à les déplacer encore. Qui façonne nos outils quotidiens, ordinateurs, téléphones, vélos, voitures et machines à laver ? Qui nous raconte ce qui est désirable ou non ? Impossible de laisser plus longtemps à Google et aux transhumanistes le monopole d’un futur désirable, de les autoriser à définir à notre place l'émancipation et le fonctionnel. Repenser notre quotidien en termes très matériels, depuis notre réveil le matin jusqu’à notre source d'électricité, depuis les moyens de nous divertir jusqu’à ceux de nous déplacer, était à chaque labo-fiction une dynamique bouleversante qui nous redonnait du pouvoir d’agir en s’appuyant sur les connaissances techniques disséminées dans l’assemblée.
La juxtaposition de visions fragmentées a souvent contribué à rendre imaginable un monde hors de l’organisation capitaliste de la production mais néanmoins relativement confortable. Les désaccords entre participantEs se sont bien sûr joués dans ce « relativement », ce qui paraissait indispensable aux unEs ne l’étant pas nécessairement aux autres. Et derrière ces discussions très concrètes se sont invitées, par la petite porte de la fiction, de nombreuses questions de fond sur le thème du plaisir, de l’individualisme et du collectivisme, sur les notions de progrès et de croissance, le rapport à la vitesse et à la distance, à la souffrance, au manque, au vieillissement et à la mort, à l’exploitation et aux injustices, aux écosystèmes et aux technologies. Sans jamais cesser d’explorer ce qui nous paraissait au fond à la fois réaliste et désirable.
— J’habite à Annaba, en Algérie, depuis le début des mouvements insurrectionnels. J’avais envie d’habiter le pays de mes parents, j’étais fatigué de vivre dans un pays colonisateur… Maintenant je travaille dans une filature, une usine de tissage si tu préfères.
— Pfffou, ça n’existe plus les usines de vêtements ! On les a arrêtées, on vit sur l’existant de l’Antémonde. Moi j’suis institutrice dans mon quartier.
— Pardon ? Aucune filature ? Tu portes bien des fringues là ? Et les gosses de ta classe aussi ?
— Je suis habillée de récup, on rapièce les tissus ensemble, c’est même devenu la mode. L’Antémonde a produit tellement de vêtements, qu’on peut les recycler jusqu’à la fin des temps ! J’habite un immeuble où les fringues n’appartiennent à personne, on se les échange comme bon nous semble.
— C’est plutôt rigolo ton histoire, mais vous faites toutes et tous la même taille ?
— On en a de toutes les tailles, c’est l’opulence je te dis !
— Et les sous-vêtements sont collectifs aussi ? Et qui s’occupe des lessives ?
— On a des tours de ménage mais ce n’est pas si simple… Avec toutes nos activités, laver n’est pas la priorité… alors on n’est pas très à cheval sur la propreté… et puis on vit la plupart du temps dehors. Le problème c’est surtout les mites.
— Ça me dégoûte un peu d’imaginer porter les chaussettes de mon voisin, je t’avoue.
— Ça nous permet d’en avoir de diverses sortes et de couleurs différentes !
— Tu vas me faire croire qu’après dix ans de lavage, vos habits collectifs ont encore des couleurs… J’aime travailler la laine, j’aime produire des tissus aux motifs flamboyants en travaillant avec toutes sortes de pigments. J’aime que les pulls, les chaussettes, les châles qui sortent de nos métiers et tricoteuses soient portées et que le travail qu’on a fait pour les créer soit estimé. Je suis reconnaissant aux moutons et j’aimerais que les humainEs qui portent nos vêtements le soient aussi envers nous et qu’iels prennent soin de conserver leurs affaires.
— T’es un peu moralisateur là.
— Peut-être. Mais ces vêtements que tu rapièces, ils étaient produits dans des énormes usines à Bombay, par des enfants ou des jeunes femmes surexploitéEs.
— Je suis d’accord. C’est pour ça qu’on a stoppé leur production, pour ne plus les asservir.
— Mais ce n’est pas suffisant comme geste. On ne peut se passer de vêtements. Se réapproprier les savoir-faire de tisserand, c’est vital.
— Je pense qu’on partage quand même une problématique similaire autour des mites. Vous utilisez quoi comme répulsif ?
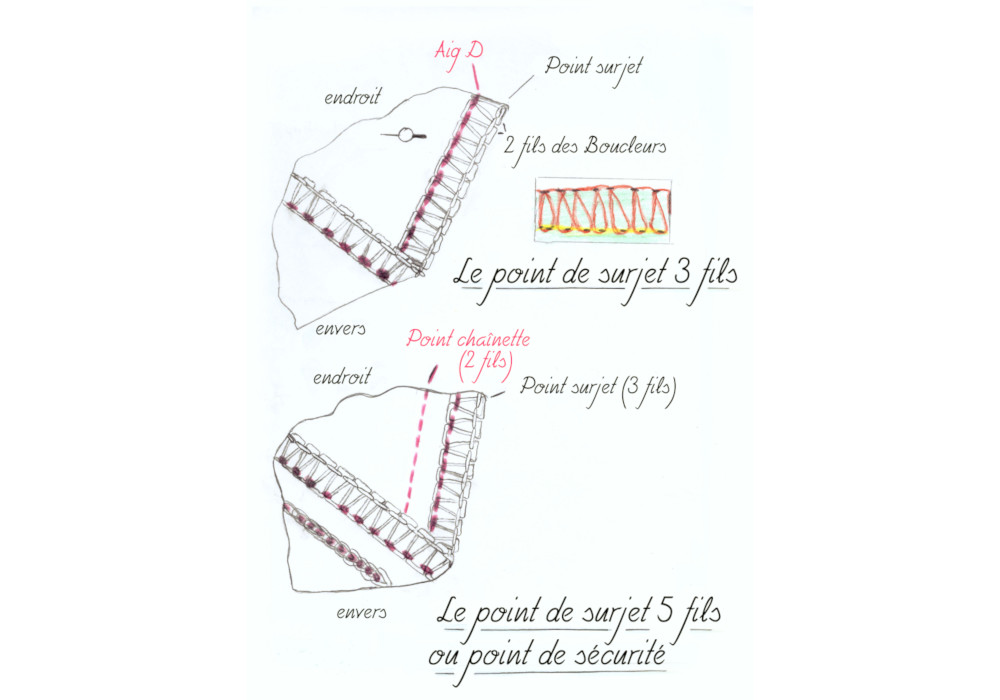
Coudre: discuter le modèle, découper le patron, assembler les pièces à la surjeteuse
Lorsque nous avons débuté la tournée en septembre 2018, nous avons été surprisEs par le pessimisme qui dominait les ateliers. Un imaginaire de survie, de repli sur soi, de loi du plus fort. Les espoirs de prospérité et de justice sociale étaient bien démolis par quatre décennies d’ultralibéralisme et de remontée des fascismes… Mais nous avons surtout pu mesurer que l’effroi suscité par l’urgence climatique, longtemps réservé à un cercle restreint d’écologistes, s’était invité pour de bon dans la conscience collective.
— Une révolution ? Qui a embarqué toute la société ? Victorieuse et pérenne en dix ans ? Ce n’est vraiment pas réaliste…
— Essaie quand même, juste pour voir… Que fais-tu ces temps-ci, en ce mois d’octobre 2022 ? Habites-tu toujours dans le coin, dans la région bruxelloise ? Ou bien es-tu seulement de passage ?
— Bah moi, de toutes façons, je suis mort dès la deuxième année de l’Haraka, en 2012. J’étais avec mes deux gosses, quatorze et seize ans, on ramenait des conserves qu’on avait récupérées dans un entrepôt abandonné, toutes périmées, mais c’était déjà ça… et on a été attaquéEs par des types, sûrement aussi affamés que nous… Ils nous ont massacréEs en pleine rue, personne ne s’est bougé pour nous défendre.
— Ils vous ont tuéEs touTEs les trois ?
— Bah oui, les gens s’entre-tuaient, la révolution c’était vraiment la guerre, le chaos… Il y a eu énormément de victimes.
— Mais pourtant tu es là avec moi, en 2022, à me parler de tout ça… J’ai du mal à comprendre comment tu peux être mort il y a plus de dix ans et répondre à mes questions aujourd’hui…
— Ah ça, c’est que je suis un fantôme… Mon job maintenant, c’est de veiller sur les vivantEs. Tu sais qu’il n’y en a plus beaucoup maintenant. Je m’efforce de les épauler dans ce moment compliqué où ils passent eux-mêmes de la vie à la mort.
— Un peu comme un curé ?
— Oui… ou plutôt comme un croque-mort… Parce qu’avec l’effondrement de tout, les gens n’ont plus de repères, ni religieux, ni étatiques, ni sociaux, ni même psychiques… Iels sont vraiment pauméEs et ne savent plus comment faire face à la perspective de la mort, iels ont besoin qu’on leur prenne la main et qu’on leur dise que c’est normal, que tout va bien se passer, qu’on est professionnel.
— Professionnel ?
— Oui, experts de la mort : j’essaie de les accompagner avec douceur, d’être rassurant… La fin de l’humanité est inévitable mais on n’est pas obligé d’en faire quelque chose de dramatique, non ?
Au-delà des records de températures, cela nous a permis de constater encore une fois à quel point nos imaginaires du futur étaient verrouillés par l’avalanche de fictions dystopiques, dans les livres, les séries, les films, les jeux vidéos… Pourtant, les catastrophes comme l’ouragan Katrina, l’explosion de la centrale de Fukushima, comme de nombreuses situations de guerre, ont montré que la plupart du temps en situation extrême, voisinEs et inconnuEs ont pour réflexe de venir à la rescousse de celles et ceux qui en ont besoin. Les unEs font des rondes en barque dans le quartier inondé pour trouver les rescapéEs sur le toit de leurs maisons, les autres fouillent les décombres pendant des jours, les unEs cuisinent pour des affaméEs, les autres pansent leurs plaies, hébergent pour une nuit ou un an… Rares sont les films ou les romans à large audience qui mettent en scène cette solidarité… jusqu’à oublier notre capacité à la générosité et à la confiance. Les fictions utopiques que nous connaissions datent d’ailleurs presque toutes des années 1970.
Nous en étions là de ce constat de pessimisme ambiant. Nous regardions avec scepticisme la « collapsologie », partageant ses constats mais pas ses perspectives politiques. Nous sommes convaincuEs que le capitalisme peut se nourrir longtemps de la dégradation de la planète et des conditions de vie, sans que rien ne bascule vers du mieux. Mais à partir de fin novembre 2018, les labo-fiction ont commencé à muter. Quelque chose de plus fluide, de plus optimiste s’est progressivement déployée. Comme si ce désirable était plus facile à entrevoir, plus nécessaire peut-être. Comme si l’énergie formidable des gilets jaunes y résonnait et donnait à toutEs un nouvel élan. Comme un refus de s’entendre dire qu’il n’y avait aucune autre issue. Bivouacs sur les ronds-points mais aussi, au fil des mois, déflagrations de foules en Algérie, à Hong-Kong, au Chili, en Iran et au Liban : des flashs de réalité ont petit à petit émergé, en lisière des ateliers, réanimant l’imaginaire concret de mouvements populaires multiples et maillés, capables de contrer l’exploitation économique, coloniale et patriarcale. Dessiner des luttes nécessairement écologistes, avec et malgré l’effondrement, à même de transformer nos vies sur terre.

« Nous n’irons plus nuEs »
— Tu habites seule, Sonia ?
— Oui, j’ai toujours rêvé de revenir en Tunisie et d’être indépendante. Ma famille est restée à Paris… La dernière fois que mes frères m’ont rendu visite, ils ont pris le chemin long, celui qui passe par Gibraltar.
— Ils ont traversé en bateau ?
— Mais non, il y a le pont maintenant.
— Un pont de trente kilomètres ‽
— Oui oui, confirme Sonia, toujours très sérieuse. C’est un mélange de mousse et de métal, c’est large comme cinq ou six camions avec des belles barrières de buissons-algues pour casser les grandes vagues, et puis ça bouge un peu, parce que c’est un pont flottant. Mais c’est très solide. Et amusant aussi. Et ça brille la nuit. C’est un pont vivant et tout le monde peut y passer…
— Permettez que je m’immisce dans votre discussion, intervient timidement Barry. J’ai une nouvelle de la plus haute importance à partager. Une deuxième route vient de s’ouvrir un peu plus loin, une route encore plus radicale. Nous avons constaté la rencontre entre le sable de la plage libyenne et celui de la plage italienne. C’était avant-hier, un lundi, le jour où nous avons décidé d’abolir la mer Méditerranée, pour que plus personne ne puisse s’y noyer.
— Incroyable. Et comment ça se passe ?
— Et bien vous êtes en Libye, sur la plage, il vous suffit de faire un pas… et voilà, vous êtes en Italie.
Inventer des histoires, c’est visiter des lieux remplis de bruits, de couleurs et de souffles qui nous imprègnent comme si on les avait arpentés physiquement. Nous avons ainsi longé la Méditerranée qui n’était finalement pas complètement abolie. Le jour de la fête des naufragéEs, nous y avons vu des embarcations extravagantes en farandoles à perte de vue, chatoyantes de voilures et de feux, chargées de géantEs en carton-pâte, pour ne jamais oublier cellEs engloutiEs par les flots. Plus tard, nous avons déambulé dans ce gigantesque palais provincial au centre de Liège, devenu « Centrale des offres et besoins gratuits » et rebaptisé le « Palais Gueulard » car chaque jour les nouveautés y étaient criées à la volée, dans la grande cour pavée enfin libérée de ses grilles.
Les promenades furent parfois moins créatives : certainEs participantEs, déjà impliquéEs dans des structures collectives, apprécièrent l’atelier parce qu’il les renforçait dans l’idée qu’iels préparaient déjà l’avenir. Leurs pratiques « alternatives », AMAP, bibliothèque libertaire, groupes activistes, maisonnées autogérées et autres coopératives agricoles se prolongeaient comme futurs désirables et il n’y avait donc plus grand chose à inventer. Mais, ces initiatives n’ayant pas encore aboli le système capitaliste et colonial, si le reste du monde se mettait à changer tout autour, les choses se transformeraient aussi pour celles et ceux qui construisent aujourd’hui ces poches de dissidence.
D’autres participantEs nous renvoyèrent une image troublante, une sorte de mise en abîme de nos propres postures militantes. Incapables de s’imaginer autrement qu’en lutte et en minorité, même dans notre scénario de révolution victorieuse, iels trouvaient d’autres marges de contestation, comme si la vie sans résistance était inconcevable.
Les surprises sont parfois venues de participantEs moins habituéEs aux ambiances militantes. Quelqu-unEs arrivèrent en se déclarant favorables au capitalisme ou même à l’industrie nucléaire, hostiles aux élans collectifs de masse et aux idéologies gauchisantes… Mais dans le jeu s’opéra souvent une magie inclusive qui les fit sortir de la méfiance et accéder à l’imaginaire d’un changement de société radical. L’une déclara avoir fui dans une enclave capitaliste pour conserver son confort… avant de revenir pour rendre visite à ses filles restées en Haraka, où la vie lui avait finalement semblée douce. Un autre, imaginant un monde toujours capitaliste-libéral avec seulement de petites enclaves haraks, reconnut en cours d’atelier, après avoir travaillé sur les notions de frontières et de contrainte armée, qu’aucune sortie partielle du capitalisme ne serait tolérée par le système dominant et qu’il fallait donc étendre largement l’Haraka… Un dernier participant, initialement favorable au maintien des infrastructures nucléaires, ressortit après trois heures en ayant réalisé l’étendue de leur nocivité… et décidé à lutter contre.
Dans de nombreux ateliers, les participantEs se lancèrent d’abord avec timidité, se projetant dans des mondes assez semblables au leur et s’imaginant continuer à faire ce qu’iels savaient déjà faire, tranquillement. Plutôt que d’explorer l’inconnu, iels redessinaient leur propres conditions de travail, leur quotidien. Iels étaient assurément bien assez expertEs de leur propre vie pour savoir ce qui pourrait y être amélioré. Deux aides-soignantes en maisons de retraite se demandèrent ainsi selon quels rythmes de travail et dans quelle mixité d’âge elles seraient encore prêtes à s’impliquer dans des maisonnées collectives pour personnes isolées et dépendantes. Une détenue nous décrivit la prison dans laquelle elle était alors enfermée comme un logement communautaire fourmillant de vie et ouvert sur le quartier, avec une piscine à la place de la cour de promenade et une fête immense, juste pour le plaisir de faire la fête. Faire la fête, faire les choses bien, faire des choses qui font sens. Nous avons eu, à de nombreuses reprises, la sensation d’un travail syndical en train de se faire, d’un espace où chacunE s’autorisait, peut-être pour la première fois, à lister les éléments concrets qui amélioreraient les conditions de vie et de travail à large échelle.

Pousser les murs de l’atelier !
— Et toutes ces bites en métal sur les trottoirs, on en fait quoi ? demande l’unE d’entre nous trois en slalomant dans une rue toulousaine, portéE par l’énergie du labo-fiction qui vient de se terminer.
— C’est vrai qu’elles sont inutiles maintenant. C’est plus la peine d’empêcher les voitures de se garer partout, vu le peu qu’il en reste…
— Les bites ? Elles ont été refondues ! C’est super précieux le métal…
— Ça permet de fabriquer de nouvelles têtes de bêches, de râteaux, de pelles ! Il y a tellement de gens qui travaillent la terre maintenant.
— Et tout ce bitume, il devient quoi ? Comment on le répare ? Ou par quoi on le remplace ?
— On le remplace par du sol rouge, vous voyez cette roche volcanique concassée, comment ça s’appelle déjà ?
— La latérite. Pourquoi pas… Il y a aussi les bauxites de Provence et du Languedoc donc et ce serait possible d’en acheminer par les fleuves — No way, imagine la poussière que ça va générer à chaque passage de véhicule. Les yeux en permanence irrités… Je préfère encore qu’on lance des grands chantiers repavage sur toute la ville. Ce sera éprouvant physiquement mais à des tas d’humainEs, on va en tailler du caillou ! Et une fois posé, ça durera longtemps.
— On a remplacé la plupart des véhicules à moteur par des cycles et tu veux paver les chemins ? C’est l’enfer pour se déplacer en vélo, ça secoue dans tous les sens…
— On pourrait laisser en terre battue la plupart des voies et en bitumer seulement certaines…
— Non, je mise sur les pavés, les camions et la marche à pied.
— Alors on n’habitera sûrement pas au même endroit.
Depuis 2011, nous les avons sacrément usées, nos lunettes supersoniques de l’utopie merdique ! Avec la tournée, l’effet filtre s’est intensifié : toutes ces heures d’ateliers, les balades avec cellEs qui nous accueillaient et ces nombreuses soirées où nous continuions à dessiner l’Haraka avec les plus enthousiastes des participantEs… qui avaient à leur tour de plus en plus de mal à s’arrêter.
Quand la tournée nous a ramenéEs dans la même ville à une semaine d’écart et qu’un tiers des participantEs est revenu pour le second atelier, l’une nous a balancé, sur un ton de semi reproche : « Je ne pense qu’à ça depuis une semaine. C’est bien votre machin, mais ça rend complètement accro ! » Oui, ça fait beaucoup d’heures de rêves éveillés cumulées, ça fait décoller et un peu perdre pied. Une fois la tournée achevée, de retour chez soi, comment digérer ? Même s’il y a les luttes, les manifs, le mouvement social, l’effet de manque est là, l’addiction à une pratique stimulante maintes fois répétée. Et puis nous sommes passéEs à tellement d’endroits en une année, que le bouche à oreille et le buzz d’Internet ont fait leur effet : depuis des mois maintenant, nous recevons une à deux invitations par semaine, la plupart vraiment alléchantes… mais nous n’avons pas le temps, pas les sous, d’autres engagements, la nécessité de gagner notre croûte, de prendre soin de notre maisonnée, d’atterrir quelque part… L’utopie merdique est notre nouvelle drogue avec ses effets de sevrage à accepter, la gueule de bois, la dépression qui pointe son nez. Et l’envie de laisser décanter, mais encore plus le besoin d’y retourner, de continuer à explorer cette autre réalité.
Chaque labo-fiction se termine par un temps de bilan, de reconnexion avec le présent, un sas pour sortir du jeu de rôle. Beaucoup de participantEs furent spécialement frappéEs que cette confrontation à une version inventée d’iels-mêmes les ramène à ce point à leur présent, à leurs places ici et maintenant. Dans les retours, beaucoup d’excitation joyeuse, des envies de poursuivre l’exercice et la sensation souvent d’y trouver l’élan de fuir ou la force de lutter. Pour que ce futur désirable devienne plus qu’un moment d’imagination.
Le format des ateliers est volontairement simple, dans l’espoir que la pratique se diffuse. Plusieurs participantEs nous ont demandé de leur en détailler le déroulement pour organiser de nouveaux ateliers avec l’envie de prolonger le plaisir, d’affiner les imaginaires ou de renouveler les formes de travail dans leurs groupes.
Le moteur de l’atelier, visiter ensemble le quotidien dix ans après un bouleversement social majeur, pourrait fonctionner en faisant basculer l’Histoire avec d’autres événements que les révoltes de 2011. Imaginons un 2028, parti des gilets jaunes et des ronds-points. Imaginons un 2029, parti de la grève des femmes en Suisse. Imaginons un 2030, parti d’un coronavirus faisant tomber la finance internationale. Démarrons avec des mouvements de révolte qui nous animent, ou arrêtons-nous sur des thèmes plus spécifiques, comme l’avenir d’un lieu collectif pour lequel nous nous battons aujourd’hui, une région où nous vivons avec sa constellation d’enjeux particulière, ou encore les questions liées aux frontières, à l’éducation, à la santé, à la justice ou à la production alimentaire…
Au milieu des nombreuses invitations enthousiasmantes, quelques-unes nous ont cependant posé problème. Nous voulons plus que tout partager. Nous avons créé cet outil dans une visée émancipatrice et de transformation sociale. Mais pas question d’outiller des patrons et autres managers pour valider leur idée que le capitalisme pourrait être éthique, ou que leurs salariéEs auraient les mêmes intérêts qu’eux à imaginer un avenir commun. Nous avons ainsi été sollicitéEs dans le cadre d’une rencontre sur les politiques publiques d’urbanisme à l’échelle d’une métropole, auprès des salariéEs dans une grande entreprise, ou encore dans un festival très institutionnel sur la transition énergétique à l’échelle européenne. Nous avons cherché à comprendre qui nous rencontrerions concrètement et à quel point notre présence cautionnerait des perspectives politiques contraires à nos convictions. La récupération politique nous a paru à plusieurs reprises inévitable et nous n’avons pas donné suite.
Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas seulEs dans cette démarche. Les initiatives semblables se multiplient. Nous avons par exemple été contactéEs par « Les Historiens du futur » qui documentent depuis l’an 2118 l’avènement d’une société égalitaire au 21ème siècle. Nous avons aussi croisé l’Université des Pluralités, désireuse de « détecter, connecter, fédérer les personnes et les organisations qui mobilisent les ressources de l’imaginaire pour explorer d’autres futurs ». Nous avons enfin rencontré certainEs autricEs et éditricEs de science-fiction désireusEs de moduler leurs univers dystopiques de perspectives plus désirables.
Face aux urgences sociales et climatiques, le discours politicien martèle startup, innovations et mesures d’impact. Comme si s’entêter à pousser plus loin capitalisme et technologies associées pouvait régler les problèmes causés par le capitalisme et les technologies. Le greenwashing de la pétrochimie, les délires de voitures électriques individuelles et les autres lubies des producteurs du désastre ont de quoi nous plomber. Mais si la seule alternative à cette fuite en avant reste le nihilisme à la sauce tout est foutu… alors oui, nous sommes effectivement foutuEs. Esquissons d’autres perspectives, multiplions les hypothèses parcellaires et oniriques pour parvenir à penser où nous aimerions aller, pour raviver nos joies, nos rages, nos désirs. Sans trop figer ni unifier mais en prisant les sensations fortes et joueuses, l’intuition que nous pourrions tenter l’aventure. À nous de multiplier, amplifier et prolonger des futurs résolument technocritiques. Quelles machines voulons-nous briser ? Et quels savoirs techniques voulons-nous arracher aux logiques extractivistes et productivistes ? Ne laissons pas la vulgarisation scientifique et les ateliers Do It Yourself nourrir le capitalisme. Faisons-en notre grain à moudre. Autorisons-nous à repenser la place des technologies dans nos quotidiens et leurs enjeux bien tangibles. Inventons des écologies radicales positives. Ramifions les destinations par centaines et nourrissons nos luttes d’aujourd’hui.
Merci à toutes les personnes, collectifs, associations, institutions, maisonnées, hangars et jardins qui nous ont accueilliEs, nourriEs, inspiréEs. Merci à toutEs ces êtres incroyables qui ont contribué à épaissir l’univers de l’Haraka.
Continuons ensemble à rêver des organisations sociales autrement plus vivables, que ces rêves surpassent ceux des technocrates, qu’ils se transforment en chants de lutte et de réjouissance. Cela concerne bien chacunE d’entre nous, tant nous sommes toutEs légitimes à imaginer des avenirs dignes d'être vécus.
mars 2020
les ateliers de l’Antémonde
Quand nous tirons les fils
sur l’air de « Quand on arrive en ville » de Starmania
Quand tout est difficile
Que ta vie va nulle part
Qu’la dystopie te vrille
Tout n’est que désespoir
Une lumière dans un bar
L’affiche sur le parking
De villages en buildings
Rejoins donc les bizarres
Ensemble, préparons-nous pour le grand soir…
Quand nous tirons les fils…
Quand nous tirons les fils
Pas question de lavoir
Le linge dans les machines
On se f'ra pas avoir
C’est l’État qui vacille
Plus d’patrons, plus d’argent
C’est vraiment très puissant
De rêver et d’y croire
Ça fait, comme un éclair dans le brouillard.
Quand nous tirons les fils…
REFRAIN :
Nous, tout ce qu’on veut, c’est être nombreuses
Être nombreux pour mettre le feu
On n’a pas l’temps d’attendre, on l’fait maint’nant
Nous, Bâtir aussi, c’est ce qu’on veut
Être nombreus’à se prendr’au jeu
On bricole tout ce qu’on veut en tâtonnant
Quand nous tirons les fils
C’est vingt minutes à deux
Pas besoin d’être habile
Pour voir 2022.
T’es p'têt restéE en ville
Ou alors t’as bougé ?
Avec qui tu habites ?
Tu fais quoi d’tes soirées ?
Alors, c'est quoi la vie sans travailler ?
Quand nous tirons les fils…
Un cercle hétérogène
Où tout l’monde peut se voir
Au départ y’a d’la gêne
Et vite c’est une bouilloire
L’autarcie immobile
Ça nous paraît bizarre
Les liens s’avèrent utiles
Pour reprendre du pouvoir
Alors, tout s’mêle, dans un joyeux bazar
Quand nous tirons les fils…
REFRAIN
Quand viendra l’Haraka
Ça f’ra déjà dix ans
On en parle au présent
C'est bien pour mieux y croire.
Qu'est-ce qui reste de l'histoire ?
On n'aura pas tout cassé.
C'qui reste à inventer
C'est bien ça qu'on doit voir.
Pour que tout ça devienne prémonitoire
Rencontrons-nous dans nos histoires
Tout s’mêle dans un joyeux bazar
Quand nous tirons les fils…
